Accueil > La revue > Les dossiers de N’Autre école > Les entretiens > Quelle démocratisation scolaire ? Entretien avec Jérôme Deauvieau
 Quelle démocratisation scolaire ? Entretien avec Jérôme Deauvieau
Quelle démocratisation scolaire ? Entretien avec Jérôme Deauvieau
jeudi 27 mai 2010, par
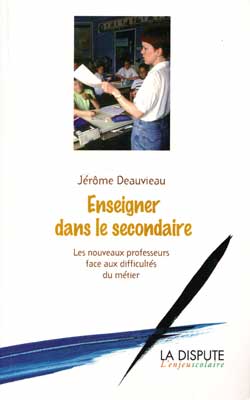
Tu participes au GRDS (Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire). Peux-tu nous présenter son travail et ses orientations ?
Jérôme Deauvieau – Le GRDS est un groupe qui rassemble des chercheurs professionnels et non professionnels (ces derniers étant issus du mouvement syndical et politique). Il vise à contribuer par ses travaux, textes et publications, à l’objectif de la démocratisation scolaire. Considérant l’école comme un grand enjeu politique, il entend s’emparer des questions touchant à sa transformation démocratique avec toute l’audace intellectuelle et la liberté d’esprit requises. Ce dernier point est important. L’un des constats partagés par les membres de ce groupe est le fait que la réflexion progressiste politique et/ou syndicale est actuellement en panne sur les questions liées à l’école et à sa transformation. Nous souhaitons donc, par nos interventions, nourrir la réflexion sur l’école dans le but d’œuvrer à la démocratisation scolaire.
Peux-tu nous présenter brièvement les enjeux sociologiques de la question démocratique à l’école, et en particulier nous définir cette notion de « démocratisation scolaire », son histoire et ses perspectives actuelles ?
J. D. – La question de la démocratisation scolaire est posée avec force depuis maintenant presque un demi-siècle du fait de l’avènement de l’école unique. C’est en effet à ce moment-là que le système éducatif s’unifie, que les élèves commencent tous leur scolarité au même endroit, alors qu’existaient jusqu’à présent deux réseaux de scolarisation, l’un pour le peuple et l’autre pour la bourgeoisie. Cette unification du système a permis, autant qu’elle a accompagné, une massification scolaire, autrement dit une augmentation très sensible de la part des jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire. Incontestablement, cette massification a permis une forme de démocratisation de l’accès au savoir. Pour autant, elle n’a pas permis de faire disparaître l’inégalité scolaire, au sens où les parcours des élèves restent aujourd’hui très fortement liés à leur origine sociale. La deuxième signification de la notion de « démocratisation scolaire » consiste donc à tout mettre en œuvre pour donner à chacun sa chance, et faire en sorte que l’origine sociale cesse de peser dans les destinées scolaires. C’est aujourd’hui le sens le plus commun de la notion de démocratisation scolaire. Cependant cette deuxième définition reste liée au cadre de l’école unique telle qu’elle est actuellement, c’est-à-dire une instance très concurrentielle avec ses gagnants et ses perdants. Le GRDS défend une conception beaucoup plus ambitieuse de la démocratisation scolaire à travers la notion d’école commune. Nous pensons qu’il convient de dépasser l’école unique et son organisation hiérarchisée, faite de filières de relégations pour les échoués, et de filière d’excellence pour les vainqueurs. Seule une école commune, qui amène tous les élèves au terme d’un tronc commun de l’enseignement secondaire à un haut niveau scolaire, et donc qui combat l’échec scolaire massif que nous connaissons aujourd’hui, permet une réelle démocratisation scolaire et ouvre une perspective de transformation sociale plus large encore.
Tes recherches ont porté sur l’étude des pratiques des nouveaux enseignants [1]. La question de pratiques « démocratiques » y est-elle posée ? Tu parles d’une « participation des élèves » valant « seulement pour elle-même », est-ce à dire que l’articulation transmission de savoirs ou de compétences et projet émancipateur ne fait pas sens pour ces jeunes collègues ?
J. D. – Je traite ces questions dans mon dernier ouvrage. Mon point de départ est le suivant : l’activité enseignante consiste à prendre en charge et à faire vivre en classe un dispositif de scolarisation. Ces dispositifs sont constitués des programmes d’enseignement, des horaires codifiés, des formes d’évaluation, des manuels d’enseignement. Par exemple, en sciences économiques et sociales (SES), que j’ai plus particulièrement étudiées, le dispositif de scolarisation est notamment structuré autour du principe de la participation des élèves. L’enseignement de SES ne doit pas se faire sur le modèle du cours magistral, mais plutôt sur la base des méthodes actives, ce qui se traduit par une injonction au cours dialogué.
J’ai observé la façon dont les nouveaux enseignants mettaient en pratique ces principes dans les classes « difficiles ». Sur le principe du cours dialogué, deux figures idéales typiques émergent. D’un côté ce que j’appelle l’activisme langagier, au sens où ce qui est visé avant tout est la participation des élèves, indépendamment des conséquences sur le déroulement cognitif de la séance de cours. La deuxième manière de mettre en place le cours dialogué consiste à contrôler beaucoup plus étroitement les prises de parole des élèves. La participation des élèves n’est pas un but en soi, mais a pour fonction première l’apprentissage. Dans ce cas de figure les enseignants n’hésitent pas à refuser la participation des élèves lorsqu’elle menace la viabilité cognitive de l’interaction. En règle générale, cette pratique du cours dialogué tend à entraîner des réponses plus longues et plus argumentées de la part des élèves. À l’inverse de l’activisme langagier, l’objectif du cours dialogué n’est pas uniquement la participation des élèves. L’échange en classe vise également une mise en activité intellectuelle des élèves.
Bien que n’ayant pas enquêté directement auprès des élèves, il me paraît clair que ces différentes options ne sont pas sans effet sur les acquisitions des élèves. L’activisme langagier par exemple n’est probablement pas de nature à favoriser une bonne entrée des élèves dans les apprentissages. Cependant, j’insiste également sur le fait que le rapport entre les pratiques en classe des enseignants et la posture professionnelle, qu’il s’agisse de la définition du métier ou plus largement du rapport politique à l’institution scolaire, n’entretiennent pas des rapports univoques. Il est erroné de penser que les pratiques pédagogiques découlent directement d’une volonté politique ou pédagogique explicite. Ainsi les oppositions de pratiques que je décris ne sont pas directement liées à un positionnement politique : des enseignants qui se proclament démocrates peuvent tout à fait adopter des pratiques d’activisme langagier qui ne sont pas, très probablement, de nature à favoriser la démocratisation scolaire. Pourquoi ? Car la détermination des pratiques en classe relève avant tout du rapport au savoir des enseignants, et ce registre est relativement indépendant du registre proprement politique.
Le discours sociologique a, en France, une longue tradition d’analyse de la fonction de sélection sociale de l’école. Il semble moins enclin à s’intéresser aux expériences syndicales et/ou pédagogiques qui tentent de travailler au quotidien contre cette sélection (je pense aux alternatives à l’évaluation présentées dans notre précédent numéro, ou encore aux expériences d’autogestion dans les classes). Est-ce que les recherches actuelles évoluent dans ce sens ? Et quel regard portes-tu sur ces pratiques ?
J. D. – Il est clair que la sociologie de l’éducation française ne s’est pas occupée centralement de la question de la transmission des savoirs. Jean-Pierre Terrail et moi-même avons écrit un livre sur les quelques travaux sociologiques qui ont porté sur la question de la transmission des savoirs afin de mettre à disposition du public et de susciter des travaux de recherches sur ces questions [2]. J’ai le sentiment que dans la période récente de plus en plus de recherches sociologiques prennent pour objet des questions liées à la transmission des savoirs, mais cela reste encore très minoritaire. On manque par exemple d’études sociologiques sur les pratiques pédagogiques qui se définissent comme innovantes. Les étudier sans parti pris de départ serait pourtant très intéressant, et à plus d’un titre. D’abord en elles-mêmes, afin de voir concrètement ce qu’elles recouvrent et leurs effets sur les élèves, mais aussi pour ce qu’elles nous disent en creux du fonctionnement plus global du système éducatif.
La question de la formation des enseignants est non seulement d’actualité, mais apparaît aussi comme au cœur des enjeux de transformation du système éducatif. Jean-Pierre Terrail, avec qui tu travailles, écrit « l’amélioration du rendement de l’action pédagogique ne peut passer que par une autogestion instruite et collectivement maîtrisée de l’activité enseignante ». Que faut-il entendre par là ?
J. D. – Le système éducatif donne le droit à tous les élèves de poursuivre une scolarité longue dans le secondaire tout en ne permettant pas à une part importante d’entre eux d’entrer correctement dans la culture écrite. Cette contradiction doit être gérée quotidiennement par les enseignants. Cela occasionne une très forte déstabilisation du métier enseignant, et souvent un repli sur soi, voire une mise en cause du principe même de l’ouverture des scolarités. Pour lutter contre cette situation, la seule solution consiste à mettre au cœur du débat les pratiques d’enseignement et l’organisation pédagogique de l’école. Il n’est en effet plus possible de défendre le principe de l’école unique sans proposer de solutions permettant l’amélioration de l’action pédagogique. Ces solutions ne pourront émerger et se mettre en place qu’à la condition que ces débats soient pris en charge collectivement par les enseignants. ■
[1] 1. Jérôme Deauvieau, Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux professeurs face aux difficultés du métier, La Dispute, Paris, 2009.
[2] 2. Jérôme Deauvieau et Jean-Pierre Terrail, Les Sociologues, l’école et la transmission des savoirs, La Dispute, Paris, 2007.
 N’Autre École
N’Autre École